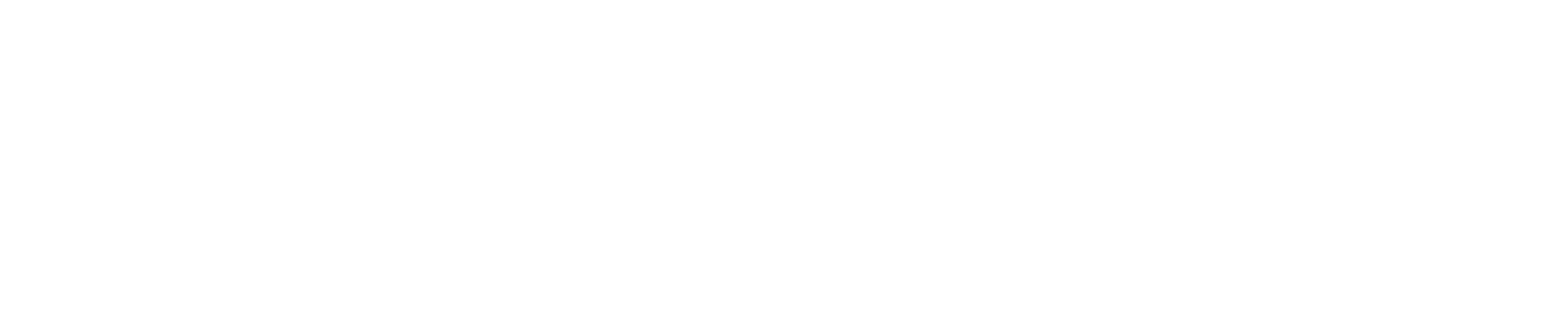Afrique – Monde Arabe: une dynamique économique
en pleine accélération – Publication UBA

L’Afrique et le monde arabe vivent un rapprochement inédit, marqué par une intensification des échanges et des alliances stratégiques. Les deux régions élargissent leur coopération au-delà du commerce traditionnel, en misant sur la finance, l’énergie verte et la révolution numérique. Une dynamique qui redessine les équilibres et positionne l’espace afro-arabe comme un acteur clé de la scène internationale.
Un partenariat stratégique en mutation
Les relations économiques entre l’Afrique et le monde arabe connaissent, en 2024-2025, une véritable accélération. Longtemps cantonnées aux échanges commerciaux classiques, elles s’élargissent désormais à de nouveaux champs : finance, énergie verte, digitalisation et intégration régionale. « Plus qu’un voisinage géographique, c’est une alliance stratégique qui s’affirme entre l’Afrique et le monde arabe », résume un expert.
Cette dynamique repose sur des avancées concrètes. Les Émirats arabes unis, en pointe, ont signé plusieurs accords commerciaux bilatéraux (CEPA) avec le Kenya, Maurice ou encore la République du Congo, avec l’ambition de doubler les flux d’échanges d’ici 2032. En parallèle, le système panafricain de paiements PAPSS s’impose progressivement comme un outil de facilitation, actif dans 17 pays dont l’Égypte, le Maroc et la Tunisie, et capable d’économiser jusqu’à 5 milliards USD de frais de transaction par an (Afreximbank). Les bailleurs arabes intensifient aussi leur action : le Groupe de coordination arabe a mobilisé près de 16 milliards USD en 2024, l’IsDB plus de 9 milliards, et l’ITFC 4 milliards pour le commerce africain.
La coopération s’illustre également dans l’énergie et la logistique. En Égypte, Masdar (EAU) et Infinity Power pilotent un projet éolien de 10 GW, tandis que DP World prévoit d’investir 3 milliards USD dans onze pays africains pour renforcer les corridors reliant le continent au monde arabe.
Commerce et investissements: la montée en puissance
Ce rapprochement repose sur une complémentarité claire : capitaux, expertise et services financiers du côté arabe ; matières premières stratégiques et marché en pleine expansion du côté africain. La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) agit comme catalyseur, fluidifiant la circulation des biens et capitaux, tandis que des hubs comme l’Égypte, le Maroc et Djibouti jouent un rôle de passerelles économiques.
Les résultats sont déjà visibles : la montée en puissance des flux afro-arabes reflète à la fois la confiance des investisseurs et le potentiel démographique d’un continent où la jeunesse constitue un moteur d’avenir.
Chiffres clés du commerce afro-arabe
Entre 2020 et 2023, les flux afro-arabes ont progressé de 15 % selon la BAD. En 2024, l’Afrique a attiré 97 milliards USD d’IDE, soit une hausse exceptionnelle de 75 % en un an (CNUCED). Parmi les projets phares, figure le gigantesque programme urbain de Ras El-Hekma en Égypte, porté par ADQ pour un montant de 35 milliards USD. La dynamique touche aussi le Maghreb : la Tunisie a enregistré 936 millions USD d’IDE en 2024 (+21 %), tandis que le Maroc a capté 1,6 milliard USD (+55 %). Au-delà des flux financiers, les perspectives démographiques renforcent l’attractivité du continent : l’Afrique représentera 20 % de la population mondiale d’ici 2030, dont près de 60 % de jeunes de moins de 25 ans (ONU).
Des dynamiques d’investissements diversifiés
Selon le World Investment Report 2024 de la CNUCED, l’Afrique a mis en place en 2024 un nombre record de réformes pro-investisseurs : 36 % des nouvelles mesures adoptées concernaient la facilitation des investissements, tandis que 20 % relevaient de la libéralisation des marchés, un niveau comparable à celui observé en Asie.
Sur le plan des origines géographiques, l’Union européenne reste le premier détenteur de stock d’IDE en Afrique (plus de 240 milliards USD), devant les États-Unis (environ 60 milliards USD) et la Chine (42 milliards USD). Cette dernière, longtemps focalisée sur les infrastructures lourdes, réoriente progressivement ses capitaux : une part croissante est désormais consacrée à la pharmaceutique, à l’agroalimentaire et aux énergies renouvelables. En parallèle, près d’un tiers des projets chinois dans le cadre de la Belt and Road Initiative (BRI) sont aujourd’hui orientés vers des infrastructures sociales (écoles, hôpitaux) et la transition énergétique, confirmant l’évolution vers une présence plus diversifiée et durable sur le continent.
Face à l’urgence climatique, l’Afrique et le monde arabe placent désormais la transition énergétique au cœur de leur partenariat. Selon l’IRENA (2024), le continent africain détient près de 60 % du meilleur potentiel solaire mondial, mais n’exploite encore qu’1 % de sa capacité photovoltaïque. Cette situation ouvre un champ immense de coopération avec les pays arabes, qui disposent à la fois de capitaux et d’une expertise technologique reconnue.
Les projets conjoints se multiplient. Dans le Sahel, plusieurs centrales solaires soutenues par la BADEA et le Fonds d’Abu Dhabi participent à l’électrification de zones rurales, alors que près de 600 millions d’Africains n’ont toujours pas accès à l’électricité (Banque mondiale, 2024). En Afrique du Nord, des programmes pilotes d’hydrogène vert voient le jour au Maroc et en Égypte, réunissant Masdar (EAU), TotalEnergies et différents fonds souverains. Le Maroc s’est fixé pour objectif d’atteindre 4 GW de capacité installée d’ici 2030, tandis que l’Égypte a déjà signé pour plus de 40 milliards USD d’accords-cadres dans ce secteur (IRENA/MEES, 2024).
Sur le plan du financement, les institutions arabes jouent également un rôle moteur. À la suite de la COP28, le Groupe de coordination arabe a engagé 15,7 milliards USD en 2024, dont une part substantielle consacrée aux projets liés au climat et à l’énergie en Afrique. « La transition verte devient un langage commun entre Afrique et pays arabes, reliant capital, savoir-faire et ressources naturelles », souligne un expert. Ces initiatives, prolongement direct des engagements de la COP28 à Dubaï, confirment le rôle des pays arabes non seulement comme bailleurs de fonds, mais aussi comme partenaires stratégiques du développement durable africain.
Banques et institutions arabes : catalyseurs du rapprochement
Les institutions financières arabes s’imposent comme des acteurs de premier plan dans la transformation du partenariat afro-arabe. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), active dans plus de 44 pays, a approuvé en 2024 près de 1,2 milliard USD de nouveaux financements, couvrant aussi bien des projets publics (routes, infrastructures énergétiques) que des programmes privés ciblant les PME et l’agriculture (Rapport BADEA, 2024).
La Banque islamique de développement (IsDB), pour sa part, a approuvé 13,2 milliards USD de financements en 2024, dont près de 3 milliards alloués à l’Afrique subsaharienne. Ses priorités incluent la santé, l’éducation, l’énergie et la résilience climatique (IsDB, 2024).
De son côté, le Fonds monétaire arabe (AMF) continue de jouer un rôle stabilisateur : en 2025, il a conclu avec la Somalie un accord de restructuration de 306,5 millions USD, destiné à appuyer les réformes macroéconomiques et renforcer la stabilité financière du pays.
En parallèle, les banques commerciales arabes renforcent leur implantation sur le continent. Les établissements marocains – comme Attijariwafa Bank et Bank of Africa – disposent aujourd’hui de plus de 6 000 agences en Afrique, couvrant près de 30 pays, tandis que les banques du Golfe et égyptiennes développent leurs réseaux en Afrique de l’Est et en Afrique subsaharienne. Cette expansion contribue à l’accélération de l’inclusion financière, dans un contexte où près de 45 % des adultes africains restent exclus du système bancaire formel (Banque mondiale, 2024).
Digitalisation et inclusion financière: un nouveau moteur
La révolution numérique agit comme un catalyseur des relations afro-arabes, en ouvrant de nouvelles perspectives pour l’accès aux services financiers. Le continent compte aujourd’hui plus de 1 000 fintechs actives – contre à peine 200 en 2017 –, principalement concentrées en Afrique du Sud, au Nigeria, en Égypte et au Kenya (Disrupt Africa, 2024). Ces jeunes pousses dynamisent le marché grâce aux paiements mobiles, portefeuilles digitaux et banques 100 % en ligne, qui redéfinissent l’expérience financière de millions de consommateurs.
L’Égypte s’affirme comme un véritable hub régional : avec plus de 40 millions d’utilisateurs de paiements mobiles et des investissements en capital-risque dépassant 800 millions USD en 2023, le pays teste des solutions innovantes avant leur diffusion sur l’ensemble du continent (Banque mondiale, 2024 ; Findexable, 2023).
Pourtant, le défi reste immense : près de 45 % des adultes africains demeurent exclus du système bancaire formel (Banque mondiale, Global Findex 2021). Dans ce contexte, la coopération afro-arabe devient un levier majeur de transformation : les banques arabes investissent dans des plateformes numériques sécurisées, des programmes de microfinance digitale et des partenariats fintech, afin de combler ce fossé et d’accélérer l’inclusion financière.
« L’inclusion financière est la clé de l’émergence africaine : les banques arabes misent su
Vers un pacte économique intégré
Au-delà des flux financiers, l’Afrique et le monde arabe s’orientent vers une vision commune de coopération structurée. Les forums conjoints – tels que le Forum afro-arabe d’investissement, les dialogues économiques de la Ligue des États arabes et de l’Union africaine – tracent les contours d’un agenda partagé. Celui-ci met l’accent sur :
• l’intégration régionale, indispensable pour fluidifier les échanges et renforcer les chaînes de valeur ;
• le soutien aux PME et à l’entrepreneuriat, qui représentent 90 % du tissu économique africain et plus de 80 % des emplois créés (BAD, 2024);
• la sécurité alimentaire, enjeu crucial alors que le continent importe encore plus de 60 milliards USD de denrées par an (FAO, 2023) ;
• la transition numérique et énergétique, moteurs de compétitivité et d’innovation.
Avec 1,5 milliard d’habitants et un PIB combiné de près de 5 000 milliards USD, l’espace afro-arabe se positionne désormais comme un pôle économique incontournable. Selon les projections de la Banque mondiale, l’Afrique à elle seule pourrait contribuer à près de 20 % de la croissance mondiale d’ici 2030, grâce à sa démographie et à l’expansion de ses marchés.
« La coopération Sud-Sud n’est plus un slogan, mais une réalité tangible. L’espace afro-arabe s’affirme comme l’un des pôles émergents les plus prometteurs du XXIe siècle », souligne un économiste interrogé.
Conclusion : un avenir partagé
Les records enregistrés en 2024 – avec des investissements directs étrangers atteignant 97 milliards USD, soit une hausse de 75 % en un an (CNUCED, 2024) – traduisent une reprise spectaculaire des flux financiers vers l’Afrique. Ce regain de confiance ouvre une nouvelle ère pour la coopération afro-arabe, désormais appelée à dépasser la logique transactionnelle pour s’inscrire dans une trajectoire stratégique et durable.
Banques, institutions régionales et États conjuguent leurs efforts afin de bâtir un pacte économique intégré, reposant sur la mobilisation de capitaux, l’innovation numérique et la transition énergétique. Les banques arabes, qui se déploient de plus en plus en Afrique subsaharienne, apparaissent comme des catalyseurs d’inclusion et de modernisation. Les institutions arabes de financement – BADEA, IsDB, AMF – assurent, quant à elles, un appui structurant à la fois pour les grands projets d’infrastructures et pour la stabilité macroéconomique.
Avec une population afro-arabe cumulée dépassant 1,5 milliard d’habitants et un PIB agrégé de 5 000 milliards USD, cet espace émerge comme un nouveau pôle de croissance mondiale (Banque mondiale, 2024). Il constitue aussi une réponse concrète à la montée des incertitudes internationales, en misant sur la coopération Sud-Sud et sur l’alignement avec les Objectifs de développement durable.
« Plus que jamais, l’heure est à l’audace, à l’intégration et à l’impact », souligne un expert, appelant à transformer cette dynamique en un véritable moteur d’émergence et d’influence globale.