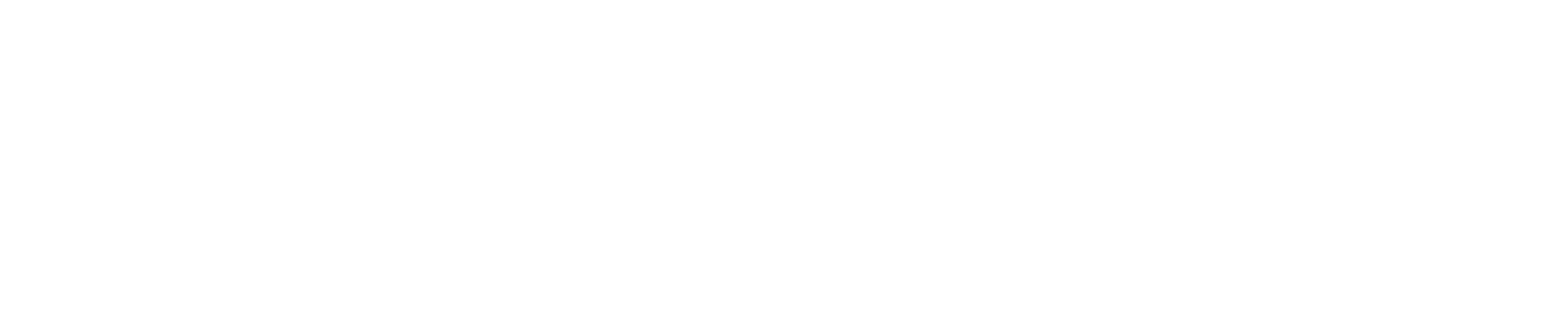Le rôle des partenariats interrégionaux dans l’accès aux marchés financiers et la mobilisation des capitaux
Dr Vera Songwe,
Fondatrice et Présidente de la
Liquidity and Sustainability Facility
Orienter les épargnes mondiales, aujourd’hui immobilisées dans des instruments à faible risque au sein des pays du G20 et des États du Golfe, afin de combler le fossé croissant entre les besoins d’investissements durables des pays en développement et le coût du financement disponible, représente l’un des plus grands défis de notre époque pour la communauté internationale. Si le G20 a joué un rôle central dans la mobilisation et la canalisation des capitaux à l’échelle mondiale, on observe désormais l’émergence de partenariats et de plateformes régionales qui s’imposent comme des leviers essentiels de la mobilisation des capitaux et du renforcement de l’inclusion financière. Le présent essai se penche sur le rôle de ces partenariats interrégionaux (PIR) et explore les moyens d’attirer davantage de capitaux vers le financement du développement durable grâce à ces mécanismes collaboratifs et innovants.
Avant la pandémie de COVID-19, la croissance mondiale s’était stabilisée autour de 3,5%, portée principalement par les marchés émergents, notamment la Chine, tandis que les économies avancées, notamment les États-Unis, affichaient une expansion robuste. Depuis lors, l’inflation persistante, les tensions géopolitiques et le resserrement des politiques monétaires ont ralenti cette dynamique. Les déséquilibres macroéconomiques observés dans de nombreuses économies avancées continuent de freiner la reprise, tandis que les chocs commerciaux accentuent la pression sur les économies émergentes à revenu intermédiaire supérieur. Les pays à revenu intermédiaire inférieur, pour leur part, font face à des charges de la dette de plus en plus lourdes, à des coûts du capital élevés et à une contraction des financements concessionnels. L’Afrique ne fait pas exception à cette tendance: malgré une résilience remarquable, la croissance du continent demeure inférieure à ses niveaux d’avant-crise, mettant en évidence les vulnérabilités structurelles auxquelles il reste confronté dans un environnement économique mondial incertain et volatil.
La croissance économique de l’Afrique devrait passer de 3,3 % en 2024 à 3,9 % en 2025, puis atteindre 4 % en 2026. Bien que ces taux demeurent inférieurs aux 6% de croissance enregistrés au début des deux dernières décennies, cette trajectoire demeure encourageante, car elle témoigne d’un retour progressif de la dynamique économique sur le continent.
Cependant, pour réduire significativement la pauvreté et améliorer les conditions de vie, l’Afrique devra maintenir une croissance moyenne supérieure à 8 % sur le long terme. Un tel objectif exige une hausse substantielle de l’épargne et de l’investissement, ainsi qu’un accès élargi à des financements plus abordables.
Le continent doit donc attirer des capitaux à moindre coût et diversifier ses sources de financement afin de soutenir durablement sa trajectoire de développement et de transformer son immense potentiel économique en prospérité partagée.
Le défi de la croissance après la pandémie est différent, tout comme la stratégie de mobilisation des capitaux. Les crises mondiales telles que le changement climatique, les pandémies et le terrorisme nécessitent davantage et une meilleure coopération, ainsi qu’une structure de financement et de mobilisation différente pour y répondre.Les solutions doivent être globales, ou du moins régionales. Aucun pays ne peut à lui seul résoudre une crise pandémique ou une crise liée au terrorisme; une collaboration transfrontalière est indispensable.
En plus des défis mondiaux, l’Afrique connaît trois mégatendances qui exigent des investissements supplémentaires : la démographie, l’urbanisation et les infrastructures.
Aujourd’hui, plus de 60 % de la population africaine a moins de 25 ans. Si la tendance actuelle se poursuit, une personne sur quatre dans le monde sera africaine d’ici 2050. Cette poussée démographique nécessite d’importants investissements dans les infrastructures humaines et physiques.Cette pression démographique entraînera également une accélération de l’urbanisation. On estime que d’ici 2030, environ 700 millions de personnes supplémentaires s’installeront dans les villes[1]. La croissance urbaine de l’Afrique appellera donc un renforcement massif des infrastructures, qu’il s’agisse des routes, des télécommunications, du logement ou encore des services sociaux. Les budgets publics, à eux seuls, ne pourront pas répondre aux besoins d’investissement nécessaires pour accompagner cette expansion urbaine sans précédent.
L’Afrique doit diversifier ses sources de financement et rechercher des capitaux moins coûteux ainsi que des partenariats technologiques. Alors que l’influence et l’impact du G20 s’atténuent sous l’effet des tensions géopolitiques, les partenariats interrégionaux, notamment entre l’Afrique et les pays du Golfe, deviennent une source croissante d’investissement pour le continent.Ces partenariats interrégionaux revêtent une importance accrue pour combler les vastes déficits de financement liés aux infrastructures, à la résilience climatique et au développement, dans un contexte où les ressources multilatérales concessionnelles se font de plus en plus rares.
 Il existe trois domaines principaux dans lesquels des partenariats interrégionaux bien conçus peuvent contribuer à mobiliser et accroître les capitaux: une meilleure coopération entre les banques régionales de développement, le développement conjoint de centres financiers régionaux conformes aux normes financières internationales, ainsi qu’un plaidoyer commun des instances régionales en faveur de cadres réglementaires harmonisés.
Il existe trois domaines principaux dans lesquels des partenariats interrégionaux bien conçus peuvent contribuer à mobiliser et accroître les capitaux: une meilleure coopération entre les banques régionales de développement, le développement conjoint de centres financiers régionaux conformes aux normes financières internationales, ainsi qu’un plaidoyer commun des instances régionales en faveur de cadres réglementaires harmonisés.
Un domaine clé où les partenariats interrégionaux se développent et peuvent être renforcés concerne la coopération entre les banques régionales de développement, à l’image de la collaboration entre la Banque africaine de développement (BAD), la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) et la Banque islamique de développement (BID), pour co-créer et financer des projets communs. Ces institutions ont la capacité de mieux unir leurs forces afin de tirer parti de leur notation de crédit AAA et de fournir des capitaux de développement à moindre coût aux pays qui en ont le plus besoin.Les partenariats interrégionaux (PIR) entre banques de développement régionales permettent également de rationaliser les processus administratifs, d’accroître la transparence et d’offrir aux pays un accès à des ressources financières plus importantes Deux exemples concrets illustrent cette coopération : le partenariat entre la Banque islamique de développement, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, en collaboration avec plusieurs organisations philanthropiques, dans le cadre de l’initiative Mission 300, visant à fournir l’accès à l’électricité à plus de 300 millions de personnes en Afrique ; et le projet de la centrale hydroélectrique de Sigrobo-Ahouaty en Côte d’Ivoire, où la Banque africaine de développement s’est associée à la Société islamique d’assurance des investissements et des crédits à l’exportation (ICIEC) pour soutenir la conception et la couverture assurantielle du barrage.Les PIR peuvent ainsi mobiliser davantage de financements en amplifiant les mécanismes de cofinancement et de prêts conjoints, en réduisant les risques à travers des instruments financiers innovants, et en développant des modèles de financement mixte – incluant des prêts participatifs, des instruments de partage des risques et des solutions de désensibilisation du crédit local – afin d’attirer les investisseurs institutionnels et de stimuler le financement du développement durable en Afrique.
À la suite du rapport du G20 en Inde intitulé “Better, Bolder and Bigger MDBs”[2], les banques multilatérales de développement (BMD) ont proposé un cadre de collaboration renforcée entre institutions. En 2025, elles ont publié leur premier rapport d’avancement[3] présentant les résultats concrets de cette coopération. Parmi les principales avancées figurent la simplification des processus, une meilleure répartition des risques, l’harmonisation des données et un recours accru aux mécanismes de confiance mutuelle.Ces mesures ont permis aux BMD de mobiliser environ 150 milliards de dollars de capital libéré, générant plus de 1,4 trillion de dollars de projets. À l’échelle régionale, des résultats similaires pourraient être obtenus en adaptant et en étendant les plans d’action des BMD, tout en les ajustant aux spécificités propres à chaque région.
Le deuxième domaine des partenariats interrégionaux concerne le développement et la coopération des marchés de capitaux. L’accès aux marchés de capitaux constitue un élément essentiel de toute stratégie de mobilisation des capitaux dans les économies émergentes. Tant les pays du Golfe que les pays africains doivent intensifier leurs efforts pour renforcer et approfondir leurs marchés financiers.Les marchés obligataires du Conseil de coopération du Golfe (CCG), à l’instar de ceux de l’Afrique, restent en phase de développement. Leur ampleur demeure limitée, et les progrès réalisés concernent principalement le segment des actions, alors même que les marchés restent fortement fragmentés. Le marché des obligations, quant à lui, demeure insuffisamment développé ,une situation similaire à celle observée sur le continent africain. Les marchés africains, en outre, souffrent de fuites de capitaux, d’une vulnérabilité élevée aux chocs extérieurs et de faiblesses structurelles qui entravent leur capacité à jouer pleinement leur rôle dans la mobilisation du financement du développement.
À ce jour, les pays africains lèvent plus de 80 % de leurs financements souverains et d’entreprise sur les marchés des euro-obligations ou par l’intermédiaire des agences de crédit à l’exportation (ECA). Un marché obligataire plus développé dans les pays du CCG (Conseil de coopération du Golfe), offrant des capitaux à plus long terme et à moindre coût, représenterait une opportunité précieuse pour les États et entreprises africains.De plus, le marché du CCG pourrait offrir la diversification et la différenciation de produits dont les pays africains ont besoin. Les pays du Golfe disposent d’une expérience significative dans les émissions de sukuk, un instrument financier islamique susceptible d’intéresser plusieurs économies africaines. Le renforcement des liens et l’approfondissement des partenariats interrégionaux entre l’Afrique et le Golfe pourraient ainsi favoriser la croissance de cette classe d’actifs.Les pays du CCG représentent d’ailleurs plus de 40 % du marché mondial des sukuk en circulation. À la fin du premier trimestre 2025, les sukuk constituaient environ 40 % du marché des capitaux de dette (DCM) du CCG, le reste étant composé d’obligations. Durant cette même période, les émissions de sukuk ont chuté de 51 % en glissement annuel, atteignant 18,2 milliards de dollars, tandis que les émissions obligataires ont augmenté de 29 %. Parallèlement, les émissions liées aux critères ESG dans les marchés de capitaux du CCG ont dépassé les 50 milliards de dollars (toutes devises confondues) au premier trimestre 2025[4].
Les fonds souverains des pays du CCG constituent une base solide pour approfondir les marchés de capitaux et développer davantage de partenariats interrégionaux (PIR). En 2024, les 15 fonds souverains du CCG détenaient environ 5 000 milliards de dollars d’actifs, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Koweït et le Qatar figurant parmi les principaux détenteurs. Ces ressources pourraient être mobilisées de manière efficace et ciblée en Afrique pour répondre aux besoins en infrastructures et en technologies du continent, mais également pour accompagner l’expansion du commerce entre les pays du CCG et l’Afrique, notamment dans les domaines de l’agriculture et des minéraux stratégiques. Cependant, une stratégie de diversification des investissements des pays du CCG doit impérativement s’accompagner d’une amélioration notable du climat des affaires en Afrique. Les investisseurs doivent pouvoir rapatrier leurs capitaux plus facilement, et les législations sur les faillites, les réglementations relatives aux fusions et acquisitions ainsi que les protocoles de location doivent être clairs, transparents et simplifiés afin de favoriser la confiance et stimuler les flux d’investissement.
À mesure que les investissements en provenance des pays du CCG augmentent, les activités bancaires connaissent également une croissance soutenue. Au cours de la dernière décennie, la somme des importations et exportations entre les Émirats arabes unis et l’Afrique subsaharienne a augmenté de plus de 30 %, tandis que le commerce entre l’Arabie saoudite et l’Afrique subsaharienne est désormais douze fois supérieur à son niveau d’il y a dix ans[5].Les banques du CCG ont considérablement étendu leur présence sur le continent africain au cours de la dernière décennie. Elles profitent de l’intensification des échanges commerciaux, de la coopération énergétique, de la hausse des transferts de fonds et du développement des partenariats dans les secteurs portuaire et logistique pour établir de nouvelles succursales. À ce jour, la majorité de ces implantations se trouvent au Nigéria, en Égypte et au Soudan.En s’appuyant sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), une harmonisation des réglementations du secteur financier par les pays africains pourrait renforcer l’attractivité du continent et inciter davantage de banques du CCG à y investir et à s’y implanter durablement.
 Les investissements directs étrangers (IDE) dans les secteurs stratégiques augmentent à mesure que le commerce interrégional entre les pays du Golfe et l’Afrique se renforce. La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) a également ouvert la voie à d’importants investissements dans les infrastructures du continent.Des projets emblématiques illustrent cette dynamique, tels que l’investissement de 35 milliards de dollars des Émirats arabes unis et de l’Égypte à Ras El Hekma, la présence du groupe DP World dans de nombreux pays africains, ou encore le partenariat entre Qatar Airways et Air Rwanda — autant d’exemples du renforcement des partenariats interrégionaux (PIR) entre le Golfe et l’Afrique dans le domaine des infrastructures.Parallèlement, des entreprises comme Masdar et des acteurs énergétiques du Qatar, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis ont réalisé des investissements majeurs dans le cuivre, l’or et d’autres minerais stratégiques, notamment en République démocratique du Congo (RDC), en Zambie et au Mozambique.Le secteur agricole, en particulier en Éthiopie et au Soudan, bénéficie également de ces flux d’investissement. En revanche, les secteurs de la finance et de la banque demeurent encore sous-exploités, bien que l’on observe un intérêt croissant pour le soutien aux start-ups africaines, notamment dans la technologie financière et les solutions d’inclusion économique.
Les investissements directs étrangers (IDE) dans les secteurs stratégiques augmentent à mesure que le commerce interrégional entre les pays du Golfe et l’Afrique se renforce. La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) a également ouvert la voie à d’importants investissements dans les infrastructures du continent.Des projets emblématiques illustrent cette dynamique, tels que l’investissement de 35 milliards de dollars des Émirats arabes unis et de l’Égypte à Ras El Hekma, la présence du groupe DP World dans de nombreux pays africains, ou encore le partenariat entre Qatar Airways et Air Rwanda — autant d’exemples du renforcement des partenariats interrégionaux (PIR) entre le Golfe et l’Afrique dans le domaine des infrastructures.Parallèlement, des entreprises comme Masdar et des acteurs énergétiques du Qatar, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis ont réalisé des investissements majeurs dans le cuivre, l’or et d’autres minerais stratégiques, notamment en République démocratique du Congo (RDC), en Zambie et au Mozambique.Le secteur agricole, en particulier en Éthiopie et au Soudan, bénéficie également de ces flux d’investissement. En revanche, les secteurs de la finance et de la banque demeurent encore sous-exploités, bien que l’on observe un intérêt croissant pour le soutien aux start-ups africaines, notamment dans la technologie financière et les solutions d’inclusion économique.
Malgré l’augmentation des investissements directs étrangers (IDE) en provenance des pays du CCG vers l’Afrique, un constat récurrent persiste : la rareté de projets bancables de grande envergure capables d’attirer davantage de capitaux. Si un plus grand nombre de banques du CCG s’implantaient sur le continent, elles pourraient mieux identifier les opportunités de projets existantes, acquérir une connaissance plus fine des réalités locales et surtout mieux comprendre les besoins spécifiques du continent.La demande en projets d’infrastructures — notamment dans les transports, l’énergie, l’eau, l’intelligence artificielle et la résilience climatique — est en forte croissance dans de nombreux pays africains. Cependant, les investisseurs jugent encore beaucoup de ces projets non bancables, faute de structuration et de garanties suffisantes.Pour mobiliser davantage de capitaux, les pays du Golfe pourraient collaborer avec le secteur privé africain et les institutions régionales afin d’améliorer la bancabilité des projets. Cela passerait par la création de structures nationales de préparation de projets, par un travail conjoint avec les banques régionales de développement et les organisations régionales sectorielles (telles que les power pools), afin d’agréger les projets, de réaliser des économies d’échelle et de réduire les coûts.De plus, la mise en place d’outils de bonification du crédit, tels que des mécanismes de première perte, des garanties ou d’autres instruments de réduction des risques, permettrait de renforcer l’attractivité des projets et de stimuler la participation des investisseurs institutionnels.
L’accès mondial au capital et son utilisation sont régis par Bâle III et d’autres accords prudentiels internationaux, qui reposent largement sur l’évaluation des agences de notation. Depuis la crise financière mondiale (GFC), ces cadres prudentiels ont joué un rôle positif et essentiel en garantissant une meilleure régulation du système financier et une plus grande résilience face aux chocs économiques.Cependant, certaines réglementations prudentielles introduites à la suite de cette crise ont eu des effets négatifs non intentionnels sur les marchés émergents, touchant aussi bien les pays que les institutions financières du CCG et de l’Afrique[6][7].
En travaillant ensemble, ces régions pourraient plaider pour des cadres réglementaires mieux adaptés à leurs juridictions, tout en harmonisant leurs systèmes financiers afin d’accroître la profondeur et la portée de leurs marchés combinés. Une coopération renforcée entre l’Afrique et les pays du Golfe pourrait ainsi conduire à la création d’un pôle financier interrégional, permettant à l’Afrique de diversifier ses sources et ses coûts de financement, tout en soutenant l’ambition du CCG de développer un centre financier solide et dynamique.
Des centres financiers performants doivent veiller à respecter pleinement les exigences internationales en matière de conformité et de régulation financière, notamment celles liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et au Groupe d’action financière (GAFI), afin de préserver l’intégrité du système financier mondial. Plusieurs pays africains et arabes demeurent placés sous surveillance du GAFI en raison de déficiences structurelles dans leurs dispositifs de conformité.
En collaborant dans le cadre d’un partenariat interrégional (PIR), les deux régions pourraient mieux relever ces défis communs. Les flux financiers illicites (IFF), par exemple, demeurent un problème majeur pour l’Afrique, qui s’efforce parallèlement de mobiliser des ressources pour le développement. Par ailleurs, les pays du CCG deviennent de plus en plus une destination de ces flux, à mesure que la réglementation se durcit dans les paradis fiscaux traditionnels. L’Afrique perd chaque année plus de 50 milliards de dollars à cause des activités financières illicites.
Une harmonisation réglementaire et une coopération accrue entre les deux régions contribueraient à lutter plus efficacement contre ces flux illicites. Plus encore, des partenariats public-privé conjoints, associés à l’usage des technologies numériques et au partage de données, pourraient renforcer l’intégrité et la transparence des systèmes financiers. Enfin, le développement de monnaies numériques, telles que les stablecoins, s’il est bien encadré, pourrait également améliorer la traçabilité et la transparence des transactions financières.
Dans le contexte géopolitique actuel et face aux difficultés croissantes du financement multilatéral, les partenariats interrégionaux (PIR) représentent l’une des voies les plus prometteuses pour la mobilisation des capitaux en Afrique. Alors que la coopération financière entre l’Afrique et l’Asie s’est développée de manière constante, l’émergence des pays du Golfe comme nouvelle source de financement offrirait à l’Afrique la diversification qu’elle recherche.
Les pays africains et les États du Golfe gagneraient à tirer les enseignements des expériences passées avec l’Europe et la Chine, afin de renforcer et d’améliorer la qualité de leur partenariat. Plus de 100 milliards de dollars ont été investis au cours des deux dernières décennies, et le potentiel pour aller plus loin demeure considérable. Toutefois, ce partenariat doit être conçu de manière à créer de la valeur pour les deux parties, dans un cadre transparent, durable et équitable.
Alors que l’Afrique est confrontée à un déficit de financement du développement supérieur à un trillion de dollars, les PIR peuvent offrir l’échelle, l’innovation, le partage des risques et des investissements mutuellement bénéfiques nécessaires pour réduire cet écart en libérant davantage de capitaux privés et institutionnels.
La voie à suivre celle d’un partenariat fondé sur la prospérité partagée est désormais claire; ce qu’il reste à accomplir, c’est la mise en œuvre effective d’une feuille de route commune au service de la croissance et du développement durable des deux régions.
[1] https://www.citiesalliance.org/resources/publications/publications/africas-urbanisation-dynamics-2025-planning-africas-urban
[2] https://www.cgdev.org/publication/triple-agenda-roadmap-better-bolder-and-bigger-mdbs
[3] https://coebank.org/en/news-and-publications/ceb-publications/mdbs-comparison-report-2025/
[4] https://www.fitchratings.com/research/islamic-finance/gcc-debt-capital-market-growing-in-ems-fragmented-facing-volatility-29-04-2025
[5] https://www.weforum.org/stories/2024/04/africa-gcc-gulf-economy-partnership-emerging/
[6] https://www.project-syndicate.org/commentary/basel-iii-rules-must-be-reformed-to-drive-investment-toward-developing-economies-by-vera-songwe-et-al-2025-07
[7] https://www.ssdh.net/unlocking-em-flows