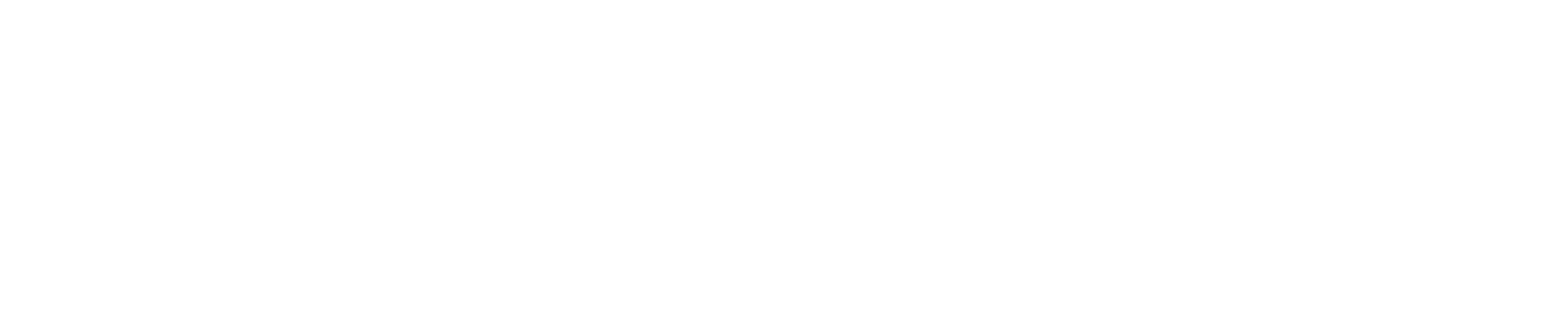Entretien exclusive avec Dr. Hanan Morsy, fondée sur les analyses, constats et recommandations du rapport du Groupe d’experts Afrique du G20:
«Croissance, dette et développement-Opportunités pour un nouveau partenariat avec l’Afrique»
(Présidence sud-africaine du G20, novembre 2025)
Afrique-G20: vers un nouveau pacte pour la croissance, la stabilité et l’investissement

Dr. Hanan Morsy
Secrétaire exécutive adjointe (Programmes)
et économiste en chef à la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique.
Et si la prospérité mondiale du XXIe siècle dépendait de la réussite économique de l’Afrique?
Au croisement des transitions démographique, énergétique et industrielle, le continent africain s’impose désormais comme l’un des principaux moteurs potentiels de la croissance mondiale. Mais cette promesse reste entravée par un financement coûteux, une dette sous pression et une architecture financière internationale encore largement inadaptée.Le Rapport 2025 du Groupe d’experts Afrique du G20 plaide pour un tournant décisif : instaurer un nouveau pacte Afrique–G20, capable d’aligner la finance mondiale sur les véritables fondamentaux économiques du continent.Dans cet entretien exclusif, Dr Hanan Morsy, Secrétaire exécutive adjointe et Économiste en chef de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, décrypte les réformes clés et esquisse les contours d’une croissance africaine durable, inclusive et stratégique – un horizon d’opportunités majeur pour les banques arabes.
Le Rapport Afrique – G20 2025
En BREF
Le Rapport 2025 du Groupe d’experts Afrique du G20 marque un tournant majeur dans la lecture du rôle économique du continent africain. Il affirme que l’Afrique n’est plus un acteur périphérique de l’économie mondiale, mais l’un de ses principaux pôles de croissance potentielle pour les décennies à venir, portée par une dynamique démographique sans équivalent, un vaste potentiel énergétique et des opportunités d’investissement parmi les plus rentables au monde.
Le rapport met toutefois en lumière un paradoxe structurel : malgré des fondamentaux solides, l’Afrique demeure freinée par un coût du capital excessivement élevé, une pression croissante sur la dette souveraine et une architecture financière internationale inadaptée, qui renchérit artificiellement le financement et limite l’investissement productif.
Face à ce constat, le Groupe d’experts appelle à instaurer un nouveau pacte Afrique–G20, fondé sur quatre axes structurants :
• une approche globale et proactive de la dette, allant au-delà du simple rééchelonnement ;
•un renforcement du rôle des banques multilatérales et régionales de développement, afin de mobiliser davantage de financements de long terme ;
•une réforme des règles financières internationales, notamment en matière de notation du risque et de régulation prudentielle;
• un effort massif en faveur de l’investissement productif, des infrastructures, de l’énergie, de l’intégration régionale et de l’innovation.
Pour les institutions financières arabes, ces orientations ouvrent un champ stratégique majeur. Le rapport souligne l’importance de renforcer la coopération financière Afrique–monde arabe et d’activer des instruments tels que le financement de projets, le financement du commerce, la finance islamique et les mécanismes de financement mixte, afin d’accompagner la transformation économique du continent et d’en partager les opportunités.
Entretien exclusive avec Dr. Hanan Morsy
1. Le rapport affirme que l’accroissement de la productivité africaine constitue l’un des principaux moteurs potentiels de la prospérité mondiale au XXIe siècle.Comment analysez-vous cette affirmation, et quelles implications concrètes en tirez-vous pour le rôle économique et stratégique de l’Afrique aujourd’hui ?
Il s’agit d’un changement fondamental de modèle de croissance. Historiquement, la croissance de l’Afrique a été tirée par l’accumulation des facteurs – davantage de travail et de capital – plutôt que par les gains de productivité globale des facteurs. Or, ce modèle a atteint ses limites. L’Afrique représente environ 17 % de la population mondiale, mais ne contribue qu’à moins de 3 % du PIB mondial. Cet écart ne traduit pas un manque de potentiel, mais un sous-investissement persistant dans les moteurs de la productivité, tels que les infrastructures, le capital humain et la technologie. La nouvelle opportunité réside dans les technologies de pointe : l’Afrique concentre près de 60 % du potentiel solaire premium mondial et environ 30 % des minerais critiques nécessaires à la transition énergétique mondiale.
Si l’Afrique parvient à accroître sa productivité, elle pourra stimuler la croissance du PIB par un effet multiplicateur, se traduisant par des créations d’emplois, une hausse des revenus et un élargissement de l’espace budgétaire. Cette dynamique ne serait pas isolée. À l’heure où l’économie mondiale recherche de nouveaux moteurs de demande et de croissance verte, la transformation structurelle de l’Afrique constitue une opportunité partagée pour l’économie mondiale.Ce potentiel est déjà perceptible, mais sa concrétisation exige un engagement clair en faveur d’un relèvement des dépenses nationales de recherche et développement à 1 % du PIB. La prospérité mondiale a besoin de nouveaux moteurs de demande, et une Afrique productive et industrialisée représente le plus puissant levier de croissance aujourd’hui disponible.
Le message est sans équivoque : la prospérité mondiale repose sur une prospérité inclusive. Et l’Afrique, à condition d’être correctement financée et pleinement intégrée aux chaînes de valeur, est en mesure d’y contribuer de manière décisive.
 2. Le rapport préconise la mise en place d’une nouvelle Initiative du G20 de refinancement de la dette, plutôt qu’un simple rééchelonnement.Pourquoi le refinancement constitue-t-il, selon vous, une réponse plus appropriée à ce stade pour les pays africains à faible revenu ?
2. Le rapport préconise la mise en place d’une nouvelle Initiative du G20 de refinancement de la dette, plutôt qu’un simple rééchelonnement.Pourquoi le refinancement constitue-t-il, selon vous, une réponse plus appropriée à ce stade pour les pays africains à faible revenu ?
Nous sommes confrontés à un mur de liquidité, et non à un simple problème de solvabilité. En 2025, l’Afrique a dû faire face à une charge de 89 milliards de dollars au titre du service de la dette extérieure, tandis que le montant prévu pour 2026 s’élève actuellement à 85 milliards de dollars. Le rééchelonnement ne fait que retarder le poids de la dette, souvent à des taux d’intérêt plus élevés. Ce dont nous avons besoin, c’est d’un reprofilage ex ante de la dette, permettant de gérer les passifs avant qu’un défaut ne survienne.
Depuis 2020, plus de 40 % du service de la dette extérieure africaine a été versé à des créanciers commerciaux, souvent à des taux d’intérêt à deux chiffres. Le refinancement permet aux pays de remplacer une dette commerciale coûteuse par des financements concessionnels de plus longue maturité, améliorant ainsi la soutenabilité de la dette et libérant un espace budgétaire en faveur des investissements prioritaires.
Le rééchelonnement reporte les remboursements sans en modifier les conditions. Le refinancement, en revanche, permet de réduire la valeur actuelle nette de la dette sans déclencher un événement de défaut, en particulier lorsqu’il est mis en œuvre de manière proactive. Pour les pays les plus vulnérables, cette approche est plus attractive et moins stigmatisante, car elle encourage une intervention précoce plutôt qu’une restructuration de dernier recours.
3. Comment une meilleure qualité des données économiques et une évolution des pratiques de notation du crédit peuvent-elles contribuer à réduire le coût de l’emprunt pour les pays africains ?
Le coût du capital est déterminé par la tarification du risque, et la tarification du risque dépend avant tout de la qualité de l’information. Or, la prime de risque actuellement appliquée à l’Afrique n’est pas justifiée par les fondamentaux économiques. Nos analyses montrent que les pays africains paient des coûts d’emprunt nettement supérieurs à ceux de pays présentant des profils macroéconomiques comparables, uniquement en raison d’un biais de perception.
Les projets d’infrastructure en Afrique soutenus par l’International Finance Corporation** affichent des performances remarquables**, avec des rendements moyens cinq fois supérieurs à ceux de l’S&P 500.Par ailleurs, les taux de défaut de ces grands projets d’infrastructure dans les pays en développement — après leur mise en service — ne sont pas supérieurs à ceux observés pour la dette d’entreprises investment grade (BBB-) dans les économies à revenu élevé. Ce constat s’appuie sur plus de 30 années de données issues du Global Emerging Markets Risk Database Consortium, qui a analysé environ 15000 prêts.
L’Afrique supporte une prime de crédibilité liée aux données : face à une opacité perçue, les investisseurs exigent des rendements plus élevés pour se prémunir contre le risque. Le renforcement de la transparence des données macroéconomiques, budgétaires et au niveau des projets peut, avec le temps, réduire les écarts de taux. Cette sur-prime détourne des milliards de dollars qui pourraient être consacrés à la santé et à l’éducation. La réponse est structurelle. Nous avançons vers la création d’une Agence africaine de notation de crédit, afin d’offrir une évaluation du risque souverain équilibrée et contextualisée.
l est tout aussi essentiel de réformer les méthodologies de notation du crédit, qui tendent à surévaluer les vulnérabilités externes et à sous-pondérer les progrès en matière de politiques publiques. Ainsi, plusieurs États africains ont maintenu des excédents primaires et mis en œuvre des réformes significatives, sans que leurs notations n’évoluent pour autant. Par ailleurs, à travers un renforcement de la supervision réglementaire, les agences de notation doivent revoir leurs approches afin de cesser de pénaliser les investissements d’infrastructure de long terme en les assimilant à des risques de liquidité de court terme.
Une meilleure qualité des données, associée à des évaluations plus cohérentes et plus transparentes, permettrait d’aboutir à des coûts d’emprunt plus équitables et d’encourager des politiques publiques prudentes et responsables.
4. Que reste-t-il à accomplir pour permettre à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) de déployer pleinement son potentiel ?
Selon nos propres estimations publiées dans le Rapport économique sur l’Afrique 2024, la Zone de libre-échange continentale africaine pourrait accroître le commerce intra-africain jusqu’à 45 % à l’horizon 2045, à condition de lever un certain nombre de freins structurels.
Le premier concerne les infrastructures. Les déficits en matière de transport, d’énergie et de technologies de l’information et de la communication (TIC) rendent le commerce en Afrique 50 % plus coûteux que la moyenne mondiale, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Cette situation pénalise la compétitivité du continent, en particulier celle des pays enclavés. L’investissement dans la logistique et la connectivité numérique est donc un levier essentiel pour libérer le potentiel de croissance de la ZLECAf.
Deuxièmement, l’harmonisation réglementaire: la simplification des normes, des procédures douanières et des mécanismes de protection des investissements permettrait de réduire les barrières non tarifaires et de créer l’effet d’échelle d’un véritable marché continental.
Troisièmement, les capacités productives : sans des écosystèmes solides dans l’industrie manufacturière et l’agro-transformation, l’accord aura un impact limité. Un soutien ciblé aux PME, le développement de zones et parcs industriels, ainsi que le renforcement des compétences sont essentiels pour en assurer le plein succès.
Quatrièmement, la réduction des coûts de transaction : le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) permet d’effectuer des échanges en monnaies locales et peut réduire les coûts de transaction de près de moitié. Il est toutefois également nécessaire d’accélérer la mise en œuvre du Protocole sur le commerce numérique afin de créer un marché numérique unifié à l’échelle continentale.En supprimant les frictions liées à la conversion des devises et en harmonisant les règles numériques, il ne s’agit pas seulement de faciliter les échanges de biens, mais de construire des chaînes de valeur régionales capables de résister aux chocs mondiaux.
La Zone de libre-échange continentale africaine constitue à la fois une réforme structurelle et une assurance face à la fragmentation de l’économie mondiale. La concrétisation de ses bénéfices suppose toutefois une coordination institutionnelle étroite, des financements adéquats et une mise en œuvre soutenue dans la durée. Dans un contexte de montée des tensions commerciales et de renforcement du protectionnisme sur des marchés partenaires clés, comme les États-Unis, le commerce intra-africain demeure notre rempart le plus fiable.
5. Quel rôle la Banque africaine de développement (BAD) et les autres institutions financières de développement africaines doivent-elles jouer dans un contexte de raréfaction des financements concessionnels ?
Des institutions comme la Banque africaine de développement sont idéalement positionnées pour combler les déficits de financement, car elles allient une connaissance fine des contextes locaux à une forte crédibilité auprès des marchés, notamment dans un contexte de recul marqué de l’aide publique bilatérale au développement, en baisse de près de 70 % dans des secteurs tels que la santé.
Elles devraient concentrer leurs efforts autour de trois priorités majeures :
1. Effet de levier : accroître le recours aux garanties et aux instruments de partage du risque. Chaque dollar de capital appelable doit permettre de catalyser des multiples de financements privés.
2. Effet d’échelle : recapitaliser les guichets concessionnels – tels que le Fonds africain de développement – afin de préserver l’accès des États fragiles au financement et de soutenir l’adaptation climatique.
3. Innovation : jouer un rôle moteur dans le déploiement de nouveaux instruments financiers, notamment les obligations liées à la durabilité, les plateformes de financement mixte, ainsi que le développement de pipelines bancables et reproductibles pour les infrastructures vertes.
À mesure que les flux concessionnels mondiaux stagnent, les institutions financières de développement africaines (DFI) doivent s’imposer comme des acteurs de première ligne, capables de porter à la fois l’impact du développement et l’innovation financière. Pour garantir un appui plus cohérent et plus robuste au développement du continent, il est indispensable de renforcer la coopération et de créer de plus fortes synergies entre les DFI africaines.Par ailleurs, il est urgent de mettre en œuvre la réaffectation des droits de tirage spéciaux (DTS) au profit des banques multilatérales de développement, telles que la Banque africaine de développement, sous forme de capital hybride. Ce mécanisme permet de transformer chaque dollar de DTS en trois à quatre dollars de nouveaux prêts. Il s’agit d’une solution éprouvée et non inflationniste pour accroître les capacités de bilan de nos institutions, sans alourdir les budgets des actionnaires.
6. Quelles sont, selon vous, les trois actions les plus urgentes que le G20 et les dirigeants africains doivent engager dès à présent ?
Nous devons passer du diagnostic à l’action, car l’enlisement du développement risque d’entraîner des effets de cicatrisation durables susceptibles d’hypothéquer définitivement les perspectives africaines.
Premièrement, mettre en œuvre un mécanisme opérationnel de refinancement de la dette pour les pays les plus vulnérables, axé sur la réduction des coûts de financement, l’allongement des maturités et l’articulation de l’allègement de la dette avec des investissements dans la résilience. Le Cadre commun du G20 réformé doit être strictement encadré dans le temps, transparent, et intégrer un moratoire automatique sur le service de la dette dès qu’un pays dépose une demande.
Deuxièmement, accélérer la réforme des banques multilatérales de développement (BMD) : s’engager à optimiser les bilans, porter la part des garanties à 20–25 %, et adapter les cadres réglementaires qui pénalisent les prêts destinés à des projets africains à fort impact. À cet égard, la reconstitution des ressources de l’Association internationale de développement (IDA21 doit être une priorité, tout comme la capitalisation des BMD, car l’Afrique a besoin de financements concessionnels bien plus élevés que ceux actuellement disponibles pour faire face à l’ampleur des crises climatique et du développement.
Troisièmement, veiller à ce que la voix institutionnelle de l’Afrique soit pleinement reflétée dans la gouvernance mondiale. Le siège de l’Union africaine au G20 doit se traduire par une influence réelle sur les politiques, en particulier en matière de commerce, de dette et de règles de financement climatique.
Quatrièmement, investir résolument dans l’économie des données, en considérant les infrastructures numériques – telles que les centres de données et le haut débit – comme de véritables actifs souverains. L’Afrique doit maîtriser les infrastructures qui alimenteront ses futurs secteurs de l’IA et de la fintech.
La fenêtre de réforme est étroite. Des ajustements marginaux ne suffiront pas à combler le déficit de financement des Objectifs de développement durable estimé à 1 300 milliards de dollars. Ce qu’il faut, ce sont des réformes structurelles capables d’aligner le potentiel africain avec les exigences de la stabilité mondiale.
Analyse de l’Union des Banques Arabes (UBA) : implications stratégiques pour le secteur bancaire arabe
La montée en puissance économique de l’Afrique ouvre une nouvelle vague d’opportunités pour les banques arabes. À mesure que le continent accélère son intégration à travers la Zone de libre-échange continentale africaine et intensifie les investissements dans les infrastructures, la transition énergétique, l’agriculture et les industries numériques, les besoins de financement sont appelés à croître fortement. Les banques arabes disposent d’atouts solides pour accompagner cette dynamique, notamment via le financement de projets, le financement du commerce, la finance islamique et les structures de financement mixte, capables de réduire les risques associés aux investissements de grande envergure.
Le renforcement des liens financiers Afrique–monde arabe sera également déterminant à mesure que le commerce transfrontalier s’intensifie et que les chaînes de valeur régionales se consolident. Dans ce contexte, l’Union des Banques Arabes peut jouer un rôle pivot : agir comme pont institutionnel entre les économies africaines et les institutions financières arabes, promouvoir la coopération, renforcer les capacités, et contribuer à la mobilisation de capitaux en soutien à la prochaine phase de croissance du continent.