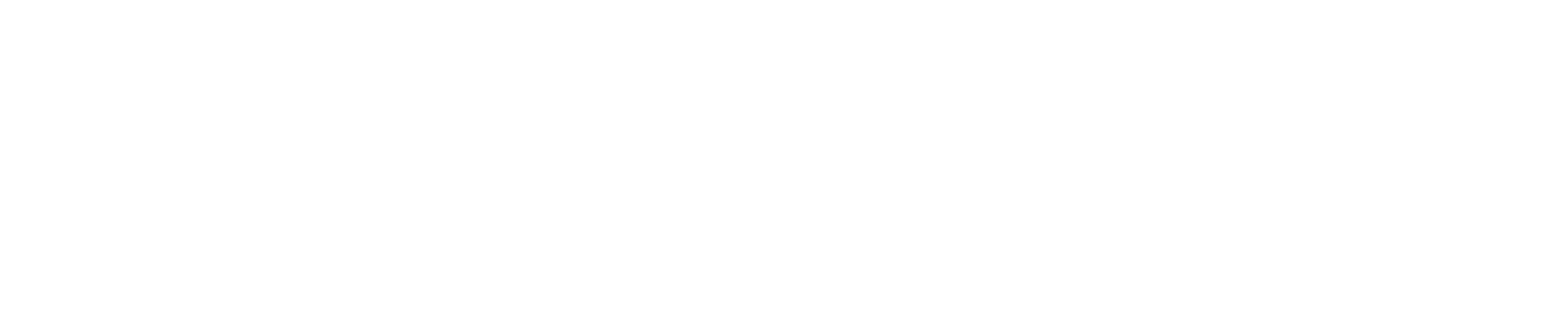Capitaux du Golfe en Afrique:
vers un nouvel âge des investissements stratégiques
Mlle Morgane Abbas
Analyste macroéconomique et financière et étudiante en Master 2 de Gouvernance Internationale et Diplomatie à Sciences Po.
Il est désormais admis que les capitaux émiratis et saoudiens occupent une place incontournable dans le paysage de l’investissement en Afrique, une montée en puissance tout-à-fait prévisible au regard des opportunités qu’offre le continent pour répondre aux impératifs stratégiques des économies du Golfe (diversification économique, sécurisation alimentaire, transition énergétique). Si l’alignement de ces investissements avec les visions nationales émirienne et saoudienne est donc naturel, la maximisation de l’impact de ces capitaux sur les économies africaines réside dans la recherche de synergie avec les enjeux dédites économies, une mission qui incombe tant aux investisseurs du Golfe qu’aux décideurs africains, et à laquelle le secteur bancaire arabe peut constituer un précieux soutien.
1) Des investissements en pente croissante: un « momentum » du Golfe?
De manière cumulative, les Émirats Arabes Unis (EAU) et l’Arabie Saoudite ont déployé 85 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) en Afrique entre 2012 et 2022, selon le World Economic Forum. Ces chiffres font d’eux les principaux investisseurs du GGC sur le continent devant le Qatar, qui continue également de multiplier les annonces d’investissements. Les EAU ont même pris la première place mondiale en termes de flux cumulés d’investissements annoncés entre 2019 et 2023 (110 Mds USD), même si la Chine ou les États-Unis conservent l’avantage en termes de stock. La force de frappe financière des fonds souverains des deux pays permet des projets d’investissements d’envergure dans l’ensemble des secteurs stratégiques des économies africaines (énergie, infrastructures, logistique, agriculture, télécoms, minerais…). Ces financements s’inscrivent dans une temporalité opportune, alors que certains partenaires traditionnels perdent du terrain. En 2024, le seul investissement émirien de 35 milliards USD dans le contexte du développement de la ville côtière de Ras el Hekma en Égypte, qui avait sauvé le pays in extremis d’une crise de change (à court-terme), a constitué le plus gros contributeur à l’augmentation des IDE entrants en Afrique. Sans ce projet, cette augmentation de 75 % n’aurait été que de 12 %, un chiffre encore faible témoignant de la nécessité de garantir de nouvelles sources de financement.
2) Quel potentiel de transformation pour les économies africaines?
• Renforcement du commerce international et intrarégional
Les investissements émiriens et saoudiens dans les infrastructures de transport et la logistique jouent un rôle clé dans le renforcement de la place des économies africaines dans le commerce international ainsi que dans l’approfondissement du commerce intrarégional.
La construction et la modernisation de ports permettent de réduire les coûts logistiques et les délais associés aux échanges commerciaux, de favoriser l’émergence de hubs logistiques majeurs améliorant la connectivité entre les différents marchés, d’augmenter les revenus douaniers et de trafic, tout en boostant la compétitivité des produits africains. Les opérateurs portuaires DP World et AD Ports sont à cet égard devenus des acteurs incontournables sur le continent, opérant conjointement sur plus d’une dizaine de ports. DP World prévoit d’ailleurs d’investir 3 milliards USD supplémentaires d’ici 2029 pour moderniser ses infrastructures portuaires sur le continent. L’Arabie Saoudite, en février dernier, a annoncé l’acquisition du port de Bagamoyo en Tanzanie pour 10 milliards USD, un investissement stratégique pour connecter les marchés africains, européens, et asiatiques. Autre exemple d’infrastructure, les EAU ont entamé l’année dernière la construction de l’aéroport international de Kidepo en Ouganda, avec des effets positifs attendus sur le commerce et le tourisme national. Quant à l’Arabie Saoudite, elle prévoit avec l’Égypte de construire le gigantesque « pont de Moïse », promettant d’augmenter et d’optimiser les flux commerciaux entre l’Afrique et l’Asie, tout en développant le tourisme entre les deux pays.
Parallèlement, le commerce intrarégional reste largement sous-exploité: il a représenté un peu plus d’un septième du commerce total de l’Afrique en 2024 (14,4 %) selon l’Afreximbank, alors même qu’il pourrait catalyser la création d’emplois, favoriser les économies d’échelle, renforcer la compétitivité des entreprises locales, et offrir une alternative dans un contexte mondial de regain protectionniste. Le déficit infrastructurel constitue l’une des principales causes de cette sous-optimisation des flux commerciaux, et la montée en puissance des investissements émiratis dans le secteur ferroviaire s’inscrit pleinement dans cet enjeu. Certains investissements permettent même de concilier commerce international et intrarégional, à l’image du projet de 3 milliards USD d’un chemin de fer reliant l’Éthiopie au port de Berbera (Somaliland), débouchant sur un accès stratégique non loin du détroit de Bab el-Mandeb.
Si ces infrastructures peuvent, dans une certaine mesure, soutenir la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et favoriser l’intégration commerciale régionale, leur impact demeure toutefois tributaire des problématiques locales, notamment la réduction des barrières non tarifaires, la lutte contre la corruption et l’instabilité politique, et l’uniformisation réglementaire.
• Dynamisation du marché du travail local
Dans un continent marqué par une expansion démographique rapide et des taux de chômage généralement élevés, les investissements du Golfe offrent des opportunités à saisir en matière de création d’emplois, directs ou indirects, et de réduction de la pauvreté.
Par exemple, au niveau des infrastructures, les impératifs de construction, d’exploitation et de maintenance des structures financées par les EAU et l’Arabie Saoudite ouvrent la voie à milliers de nouveaux postes, ainsi qu’à un transfert de compétences utile. Il est donc primordial que la population locale puisse bénéficier directement de ces opportunités, condition essentielle pour renforcer l’attractivité et la durabilité de ces investissements. La stratégie chinoise en Afrique a parfois été critiquée, accusée d’avoir privilégié une main-d’œuvre importée au détriment de l’emploi local. Pour éviter ce biais, il est impératif que les autorités locales mettent en place, en concertation avec les investisseurs, des politiques proactives d’inclusivité. Celles-ci pourraient inclure des quotas de recrutement local, mais aussi des dispositifs de protection des droits des travailleurs. En retour, la dynamisation du marché du travail stimulerait la consommation intérieure et contribuerait positivement à l’activité économique dans les pays concernés.
• Sécurisation énergétique et transition écologique
Les investissements émiratis et saoudiens dans les énergies renouvelables en Afrique participent au développement de sources énergétiques alternatives aux hydrocarbures, tout en améliorant le taux d’électrification dans le continent. Selon la Banque africaine de développement, près d’un africain sur deux n’aurait pas accès à l’électricité malgré la présence abondante d’éléments naturels, comme un rayonnement solaire important. Le renforcement de l’électrification promet de nombreux bénéfices socio-économiques: réduction de la pauvreté et amélioration des conditions de vie, alimentation énergétique des activités industrielles, construction de nouvelles infrastructures, augmentation de la productivité, création d’emplois…. Ainsi, le géant émirati Masdar s’est engagé à investir pas moins de 10 milliards USD dans les énergies renouvelables en Afrique subsaharienne d’ici 2030. Son équivalent saoudien, ACWA Power, a jusqu’à présent investi 7 milliards USD de projets renouvelables en Afrique, dont la construction de centrales solaires en Afrique du Sud (Redstone) ou au Maroc (Noor Midlet II et III), d’une usine de dessalement d’eau au Sénégal, et du plus grand parc éolien d’Égypte. Si les investissements émiratis et saoudiens dans le Oil & Gas africain n’offrent que peu de valeur ajoutée pour les économies locales, certains projets peuvent s’avérer structurants dans l’intégration énergétique régionale, comme la participation émirienne dans le financement du gazoduc Nigeria-Maroc.
• Agriculture: un enjeu partagé?
L’agriculture est au centre d’un enjeu partagé entre les pays du Golfe et le continent africain, celui de la sécurité alimentaire. Les économies golfiques demeurent fortement dépendantes des importations alimentaires, un enjeu encore plus sérieux pour l’Arabie Saoudite qui doit composer avec une pression démographique plus marquée. La sécurité alimentaire est également une préoccupation importante en Afrique. Selon le FAO, près de 20 % de la population africaine était en situation de sous-alimentation en 2022. Le continent concentre cependant une partie substantielle des terres utilisables non cultivées.
Dans ce contexte, les investissements émiratis et saoudiens, prenant principalement la forme d’acquisitions ou de locations de terres agricoles dans des pays comme l’Angola, le Soudan, ou l’Égypte, visent à accélérer et moderniser les systèmes de production. Pour maximiser ces bénéfices, des politiques inclusives devraient permettre une redistribution adéquate de la production agricole entre acteurs du Golfe et populations locales. Pour les familles affectées ou déplacées par l’utilisation de nouveaux terrains, il est essentiel de prévoir à minima des mécanismes de compensation financière ou des dispositifs d’intégration dans les activités agricoles. De manière générale, le renforcement de la gouvernance foncière est un levier indispensable pour assurer une stratégie agricole bénéfique à tous. In fine, la stratégie des deux pays en Afrique a le potentiel de renforcer la sécurité alimentaire des deux parties, tout en soutenant le transfert de technologies, l’industrialisation et la productivité du secteur, en vue d’un futur économique et social plus résilient.
• Marchés financiers
L’engagement du Golfe dans les marchés financiers africains est visible dans de nombreux secteurs. Par exemple, les fonds souverains jouent un rôle dans le soutien des start-ups africaines, améliorant le potentiel d’innovation dans des secteurs stratégiques. En mars 2024, Mubadala investissait conjointement avec BpiFrance dans le plus grand fond de capital-risque tech africain, Partech Africa II. En octobre dernier, le Fonds saoudien pour le développement (FSD) a également promis le déploiement de 5 milliards USD en soutien aux start-ups sub-sahariennes. Le secteur bancaire est également important, via l’ouverture de filiales locales comme Dubai Islamic Bank Kenya, ou encore l’octroi de lignes de crédit pour le financement du commerce comme l’a fait la Saudi Exim Bank, permettant d’appuyer les besoins de financement des acteurs locaux.
3) Rôle des banques arabes
Les banques arabes peuvent jouer rôle essentiel dans la structuration financière et le financement durable des investissements du Golfe dans les pays africains:
• Pour les grands projets, les banques arabes peuvent permettre une structure de capital équilibrée et une réduction des risques associés en complétant les capitaux propres déployés par les investisseurs du Golfe (souvent de grandes entreprises publiques) avec des prêts syndiqués.
• Les prêts syndiqués peuvent permettre à plusieurs banques arabes de mutualiser le risque de leur propre investissement tout en mobilisant des capitaux importants. En mars 2024, quatre banques émiriennes ont ainsi accordé un prêt de 1,16 milliard USD à l’Africa Finance Corporation (AFC) pour soutenir des projets d’infrastructure sur le continent.
• Les investisseurs du Golfe peuvent renforcer leur coopération avec des institutions de développement comme la Banque Arabe pour le Développement Économique de l’Afrique (BADEA), en utilisant des mécanismes comme la blended finance, qui réduisent le risque des investissements tout en finançant des projets à forte valeur ajoutée.
• Les banques islamiques peuvent jouer un rôle dans la structuration de sukuk, y compris des sukuk verts. Elles peuvent apporter un conseil financier, garantir une conformité à la charia, et agir comme des intermédiaires avec les investisseurs du Golfe. À noter cependant que les sukuk demeure un instrument limité à certains pays africains et pour l’instant relativement marginal.
• Enfin, le rôle des banques arabes s’étend aussi à la sécurisation des investissements, grâce aux garanties bancaires et à la couverture des risques locaux.