أعلى عائد على حسابات بنك القاهرة في العام 2025
أعلى عائد على حسابات بنك القاهرة في العام 2025 وشهادات الإدّخار
يطرح بنك القاهرة العديد من الأوعية الادخارية بعوائد مميّزة ومرتفعة، والتي تُعد بين أعلى فائدة على منتجات بنكية في العام 2025، ما يُساهم في جذب أكبر قدر من مدّخرات الأفراد للقنوات الرسمية، ومن أبرز المنتجات البنكية بعائد مميّز وتنافسي شهادات الإدخار وحسابات التوفير والحسابات الجارية أيضاً، موضحاً عبر موقعه الرسمي، تفاصيل شهادات بنك القاهرة2025 ، كذلك الحسابات والعوائد التفضيلية لكل منهما:
عائدات بنك القاهرة بعائد أعلى من 23% في 2025
يُمكن للأفراد الإكتتاب في العديد من شهادات بنك القاهرة 2025 والتي تتفاوت من حيث العائد ودورية صرف العائد ومدة الشهادة، فيما يصل أعلى عائد على الشهادات لـ 23.75%، ويبدأ شراء الشهادة من 1000 جنيه مصري ومضاعفات الألف.
أعلى عائد على شهادات بنك القاهرة 2025 يتم صرفه لشهادات بريمو ومدتها 3 سنوات وتصدر للأفراد بالجنيه المصري، بالميزات الآتية:
-دورية صرف عائد شهرية وربع سنوية والعائد يصل إلى 23.25% شهري و23.75% ربع سنوي.
-العائد متغيّر ومربوط بسعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري.
-قيمة الشهادة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفات الألف.

ميزات شهادة بريمو غولد من بنك القاهرة 2025
يصدر بنك القاهرة شهادات بريمو غولد للأفراد بالجنيه المصري ومدة الشهادة 3 سنوات بعائد ثابت، ويُمكن شراؤها من 10000 جنيه ومضاعفات الألف.
-عائد سنوي 17.25، أو ربع سنوي 16.25%.
-الإقتراض بضمان الشهادة حتى 90% من قيمتها.
كما يصدر بنك القاهرة شهادات بعائد ثابت يصرف شهرياً ويصل إلى 20% ومدة الشهادة 3 سنوات، ويبدأ شراؤها من 10 آلاف جنيه مصري ومضاعفات الألف.
حسابات بنك القاهرة 2025 بعائد تفضيلي
ومن بين أبرز الأوعية الإدّخارية التي تدر عائداً مميّزاً ومرتفعاً على الأرصدة المودعة في بنك القاهرة في العام 2025 هي الحسابات البنكية:
يحتسب بنك القاهرة عائداً مرتفعاً على الحسابات الجارية بالجنيه المصري يصل إلى 18% سنويا ويتم صرفه يومياً، ويُعتبر الأعلى على الأرصدة التي تتخطى قيمتها 10 ملايين جنيه، ويشترط لفتح الحساب إيداع 100 ألف جنيه حداً أدنى ويبدأ إحتساب العائد بوصول المدّخرات لـ 500 ألف جنيه.
وتنقسم شرائح الفوائد التي يتم صرفها على حساب بنك القاهرة بعائد يومي مميّز كالتالي:
-الشريحة الأولى: تبدأ من وصول الرصيد إلى 500 ألف جنيه وحتى أقل من مليون جنيه ليتم البدء في إحتساب عائد 11%.
-الشريحة الثانية: من مليون وحتى أقل من 5 ملايين جنيه يُصرف عائد سنوي 13%.
-الشريحة الثالثة: ما بين 5 إلى أقل من 10 ملايين جنيه يصل العائد إلى 17%.
-الشريحة الرابعة: ما يزيد عن 10 ملايين جنيه يصرف عائد 18%.
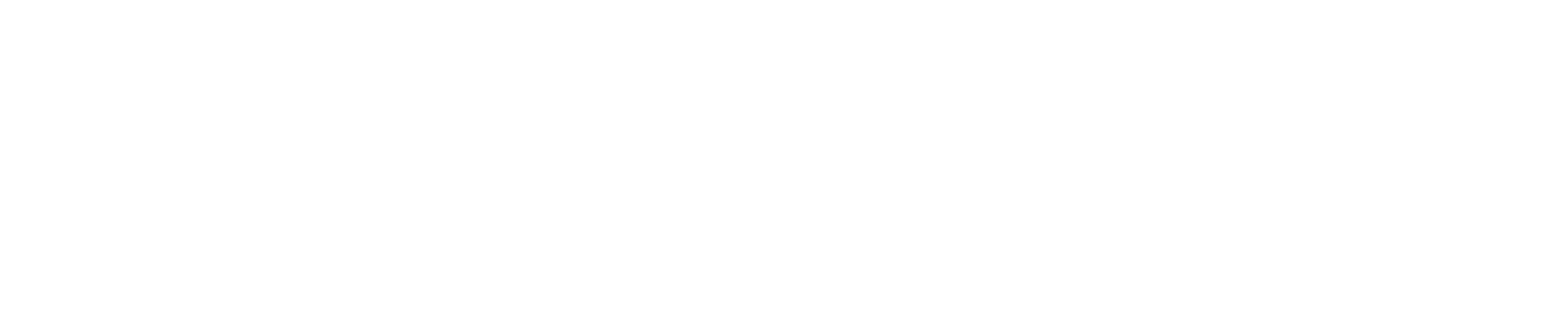







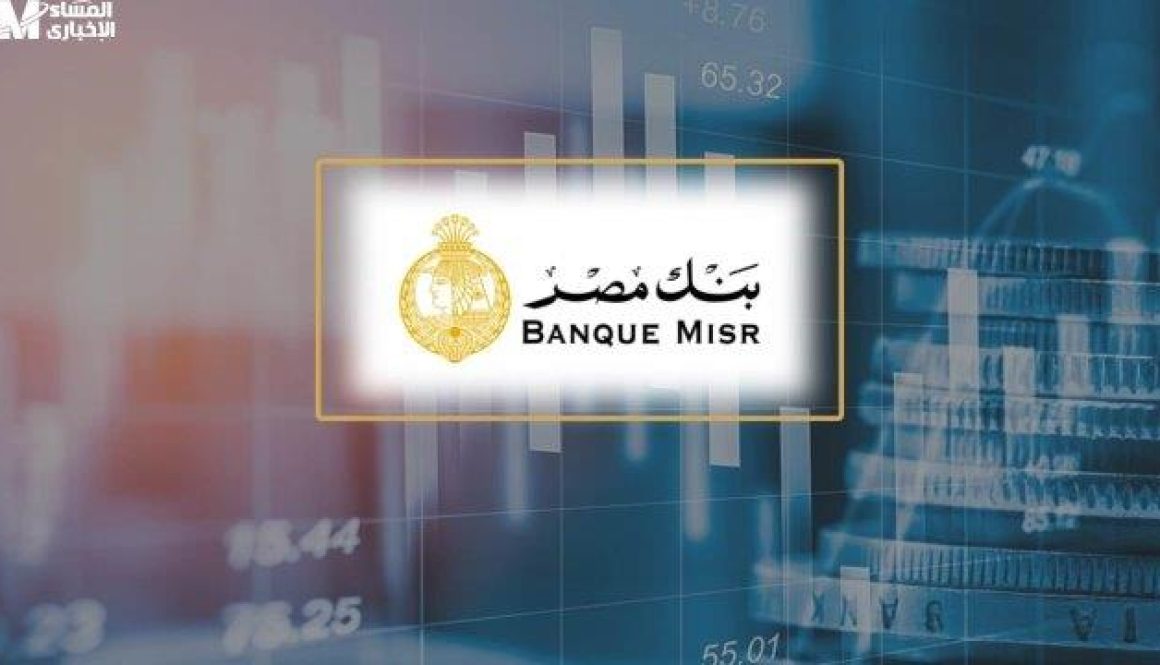




 أ
أ


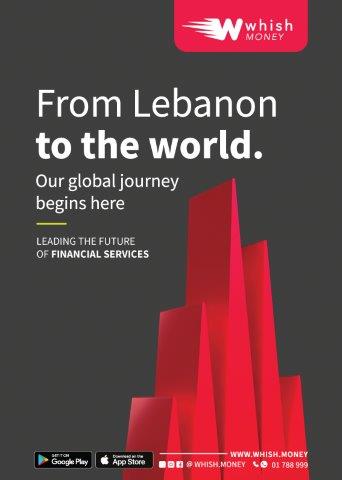







 ا
ا




















































 وقد تمّت الإضاءة خلال الحفل على إنجازات المصارف العربية، وأبرز الإنجازات المحقّقة في القطاع المصرفي العربي.
وقد تمّت الإضاءة خلال الحفل على إنجازات المصارف العربية، وأبرز الإنجازات المحقّقة في القطاع المصرفي العربي.
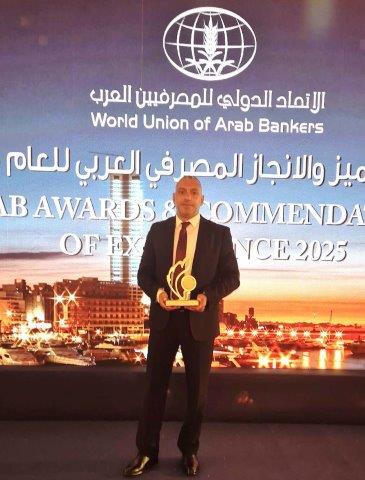





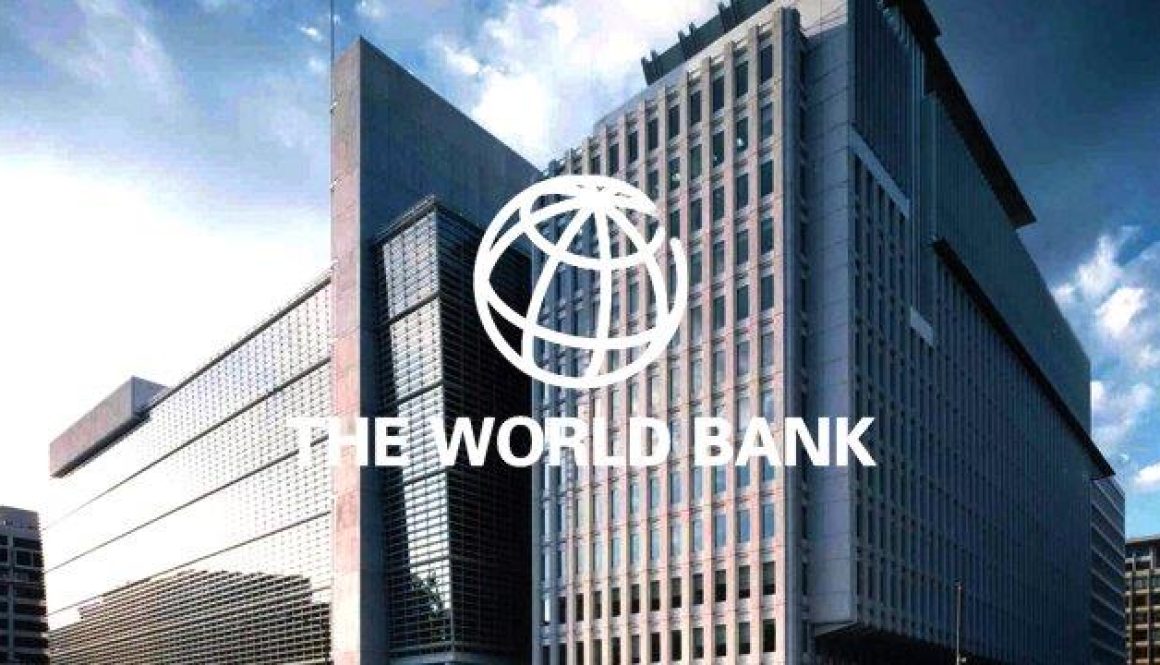
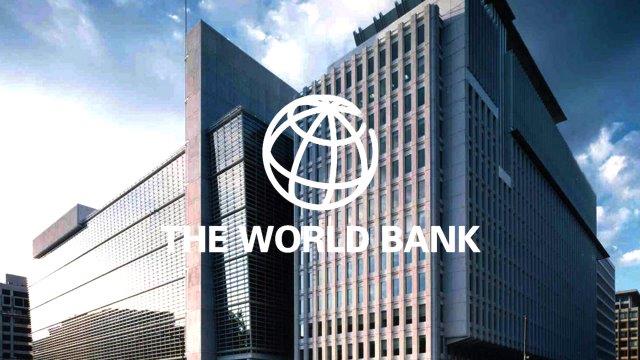
























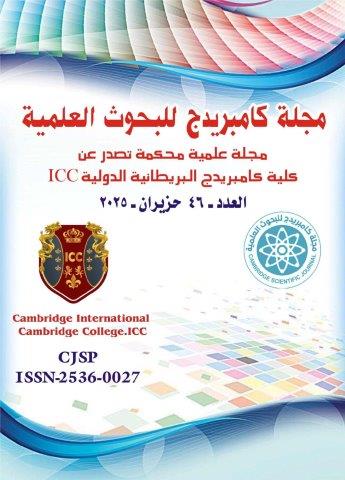
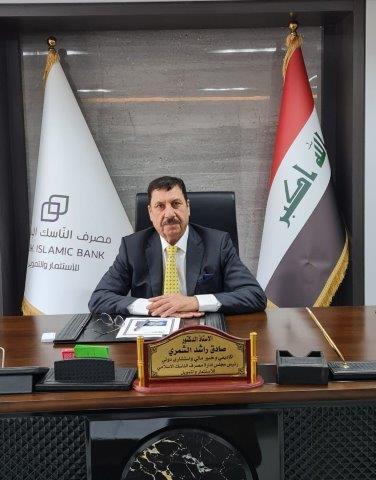

 أبرمت الخطوط الجوية القطرية، للمرة الأولى منذ 28 عاماً، إتفاقية تاريخية مع البنوك القطرية الرائدة، بقيادة مجموعة QNB والتي بموجبها، ستقدم هذه المصارف للناقلة القطرية تمويلاً قدره 4.5 مليارات ريال قطري في تمويل إستراتيجي.
أبرمت الخطوط الجوية القطرية، للمرة الأولى منذ 28 عاماً، إتفاقية تاريخية مع البنوك القطرية الرائدة، بقيادة مجموعة QNB والتي بموجبها، ستقدم هذه المصارف للناقلة القطرية تمويلاً قدره 4.5 مليارات ريال قطري في تمويل إستراتيجي.